
« Le parkour, c’est le sport le plus accessible, explique Sébastien Foucan, l’un des pionniers de la discipline et membre fondateur des Yamakasi. Tu mets tes baskets, tu vas dehors et ça commence. Il n’y a pas plus rapide, même dans le football, il faut une balle. Là, c’est juste toi et l’environnement, point. »
Au-delà de cet aspect purement sportif, une dimension plus philosophique colle aussi à la discipline. Un point sur lequel insiste Sébastien Foucan : « Dans la vie, on te met des barrières, “ne fais pas ci, ne fais pas ça”. Avec le parkour, on fait ce qu’on veut, on a l’impression d’être un super héros. Peu de choses peuvent rivaliser avec cela.»
C’est surtout le coté urbain de la discipline qui joue pour beaucoup dans sa popularité. Partout où il y a des traceurs, les passants s’arrêtent. Étonnés d’observer ces adultes qui jouent avec la ville, utilisant les kilomètres de béton et de macadam comme un immense terrain de jeux. S’appropriant la ville, grimpant là où les autres préfèrent s’asseoir, sautant quand le commun des mortels descendrait simplement les marches. Pas besoin d’acheter un ticket pour voir les sportifs, ils sont là.
Pour le sociologue Benoît Tellez, « la philosophie autour du parkour est intéressante car elle part d’Hébert et de sa méthode naturelle -qui consiste à muscler son corps grâce à des mouvements simples, ndlr- le nom est bien senti, car il n’y a pas de règle. Ce n’est donc pas étonnant que ça rencontre du succès auprès du grand public. Mais il y a un risque d’appauvrissement pour la philosophie qui entoure la discipline. »
Tant que le parkour restait un sport « undergound », du moins peu connu, la transmission de la philosophie et de l’histoire de ce sport se faisait simplement, par le bouche-à-oreille. Aujourd’hui, alors que des compétitions et les rencontres internationales réunissent plusieurs centaines de traceurs venus de toute la planète, le risque existe de voir le parkour se doter de codes, de règles universelles pour en régir sa pratique.
Instaurer des règles. Une idée que rejette en bloc Sébastien Foucan, pour qui l’absence de codes fait toute la beauté du sport. « Regardez la gymnastique. Elle aurait pu avoir également ce côté libre, mais c’est tellement rigide. Chez nous, les traceurs, il y a qu’un grand mot, c’est liberté. Enfin, c’était comme ça avant. »

© Benjamin Hourticq
Car malgré une popularité croissante et la volonté de s’institutionnaliser, le parkour souffre parfois d’une image négative auprès des autorités. A Courcouronnes, dans l’Essonne, la sculpture la Dame du Lac, ancien « parc à jeu » des Yamakasi, comme le qualifie Sébastien Foucan, est désormais interdit d’accès. « On passait des journées entières à grimper dessus, personne ne disait rien », se souvient le freerunner.
Courcouronnes n’est pas un cas isolé. À Strasbourg, en 2013, la municipalité a souhaité interdire la pratique du parkour devant le musée d’art moderne et contemporain. L’argument : éviter les accidents et, dans une moindre mesure, la dégradation du patrimoine. Aujourd’hui, les relations entre la Ville et les traceurs se sont normalisées. Strasbourg aide même PK Stras, l’association de parkour de la capitale alsacienne, à promouvoir son activité. « C’est une discipline intéressante qui plaît aux gens qui ne se reconnaissent pas auprès de l’offre sportive, comme le foot, le basket ou même la gym », estime Sylvain Delay, chargé de la politique sportive à Strasbourg. Une pratique en construction qui cherche son modèle pour évoluer, et que la FPK, la Fédération de Parkour, tente de bâtir.
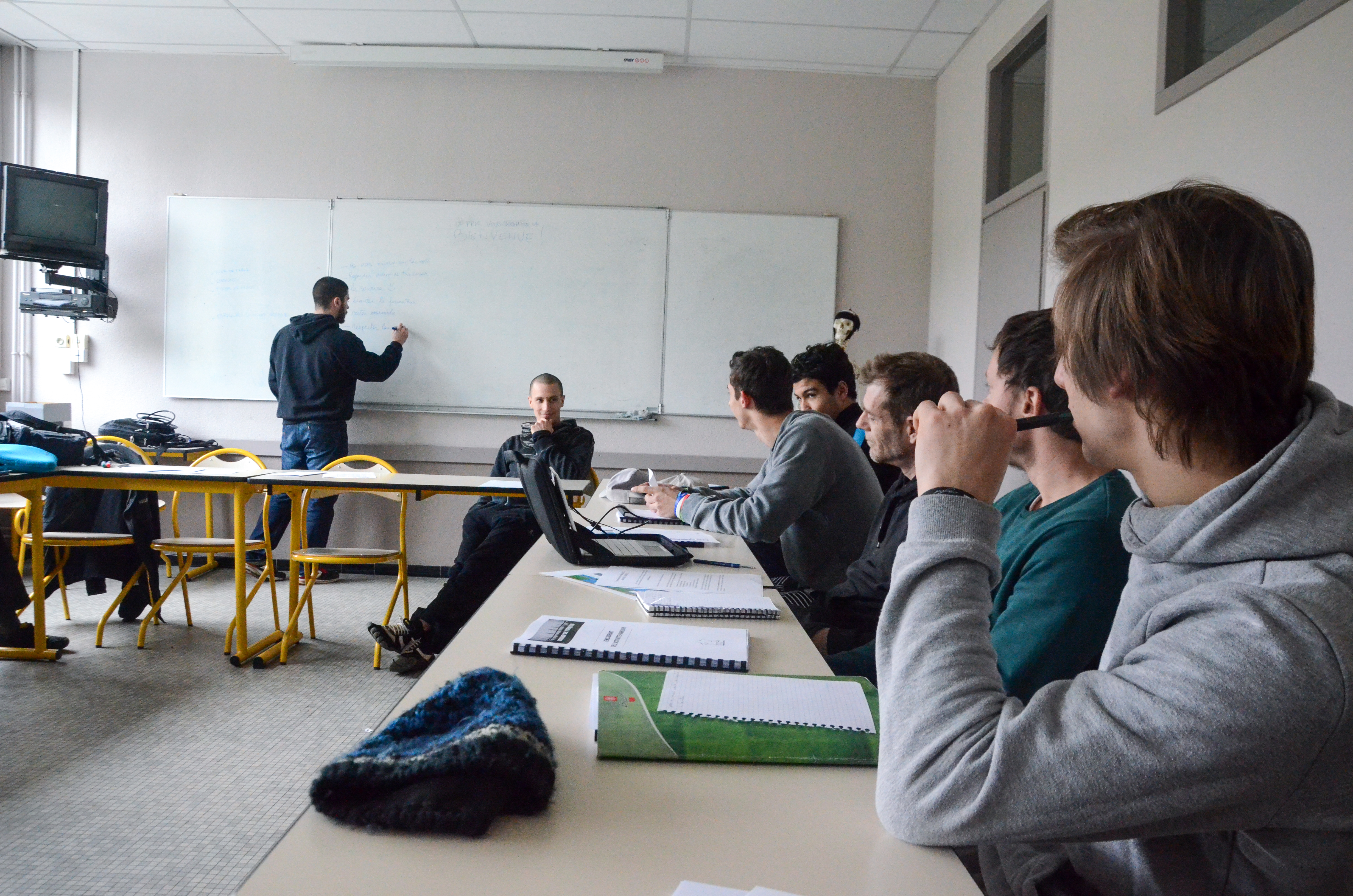
Sidney, au tableau, invite les traceurs à définir les valeurs de leur sport ©Antoine Magallon
Dijon, à la lisière de la ville, une quinzaine de traceurs entre dans une petite salle de classe, flanquée d’un nom grec, de l’un des bâtiments grisâtres du CREPS (Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive) de Bourgogne. « Ici, c’est une formation d’encadrant, pas d’athlète de haut niveau. Ce ne sont pas non plus des cours de fac. Vous êtes acteurs de votre formation autant que nous. Pour ceux que je connais déjà, vous savez bien comment ça ce passe. Pour les autres, appelez-moi Sidney. » Depuis trois ans, la FPK organise chaque année une semaine de formation. Menée par le président de la fédération, Sidney Grosprêtre, elle a pour but de délivrer un brevet fédéral d’encadrant, reconnu par l’Etat. Un diplôme nécessaire dans de nombreuses villes pour obtenir des salles d’entraînement.
La FPK est une preuve du développement de cette discipline, une étape supplémentaire vers la reconnaissance de ce sport, qualifié aujourd’hui de « pratique émergente » par le ministère. C’est aussi l’histoire longue et chaotique de la création d’un organe institutionnel dans un sport qui prône avant tout la liberté.
Avant cela, c’est via les forums que les traceurs ont commencé à échanger. « Ils se sont alors rendu compte qu’ils pouvaient aller plus loin en créant des associations », retrace David Pagnon, membre du comité directeur de la fédération. Alors que son homologue internationale, la World Freeruning Parkour Federation, a vu le jour dès octobre 2007, il faudra attendre décembre 2011 pour que naisse en France la FPK.
« Le but est de structurer la discipline et de conserver les valeurs sur lesquelles elle s’est construite. On va un peu à l’encontre de l’image du sport de casse-cou que véhiculent les médias, explique David Pagnon. Car oui, ça peut être impressionnant, oui, ça peut être dangereux, mais ce risque, on le prend en compte. »
Au programme de cette semaine de formation : 17 heures de cours théoriques, dont histoire du parkour, traumatologie et analyse du mouvement, et 16 heures d’entraînements en extérieur et en salle avant un examen final. A peine les présentations sont-elles entamées que retenti du fond de la salle un cri : « Traceurs toujours prêts : pompe ». Une phrase instaurée au fil des ans lors des rassemblements et qui invite chaque traceur à réaliser dix fois le mouvement demandé. Chacun pousse sa chaise, se jette sur le sol et enchaîne les pompes le plus rapidement possible avant de reprendre sa place, les joues rougies par l’effort.
Les cours se transforment vite en débat sur l’évolution de la pratique, les risques que prennent des traceurs russes, et les vidéos des pratiquants les plus célèbres défilent sur le rétroprojecteur. Mais c’est surtout en extérieur que la formation prend son sens. Le lendemain matin, tous se retrouvent devant la fontaine vide de l’auditorium de Dijon, alors que le thermostat grimpe péniblement au dessus des cinq degrés. Cette fois-ci, c’est Polo, le président de l’association dijonnaise, qui encadre la séance. Sur les gros blocs de bétons qui servent habituellement de bancs pour les passants, chacun improvise un échauffement que reproduiront les autres.

©Antoine Magallon
Beaucoup des futurs encadrants devront apprendre à des novices, et parfois même à des enfants, à grimper, sauter, rouler, appréhender les obstacles et, surtout, tomber sans se faire mal. Répéter les gestes encore et encore pour faire les choses bien, les faire vite et enfin les faire vite et bien, presque automatiquement. Une manière d’éviter les blessures, finalement rares dans un sport aussi spectaculaire. « Il n’y a pas beaucoup de blessures, il y en a peut-être même moins que dans les sports collectifs. Nous travaillons beaucoup dans l’axe, contrairement au football ou au basket, où il y a des changements de direction, explique Sidney Grosprêtre. Malgré les grosses contraintes, les impulsions et les réceptions, ce n’est pas un sport si traumatisant que ça, si c’est fait avec sérieux. »
Pendant toute la semaine, les traceurs travailleront les différents mouvements. Les amortis, les roulades, la gestion de l’effort pendant une séance, mais surtout comment expliquer, corriger et enseigner les bons gestes aux autres membres de leurs associations.

©Antoine Magallon
Au centre de la fontaine vide, Polo tente d’inculquer les rudiments de la roulade. « Je sais que vous maîtrisez tous, mais faites-moi volontairement une roulade ratée, comme un débutant, et après je peux vous monter comment corriger. »
Tristan, 18 ans, le plus jeune présent ce jour-là, est venu de Maubeauge, dans le Nord, pour assister à la formation. Outre son souhait de devenir pompier comme David Belle et Sébastien Foucan en leur temps, Tristan espère lui aussi faire du parkour son métier : « Je voudrais devenir éducateur sportif de parkour et avoir une salle pour la Nord Coast Familly, l’association qu’on est en train de créer. »

©Antoine Magallon

Mohammed Ayabi, traceur de l’association Parkour 59 depuis huit ans: « J’ai toujours une appréhension avant de me lancer mais j’aime les gros sauts. C’est la meilleure façon de m’exprimer, je ne fais pas que ça, mais voler dans les airs donne une grosse impression de liberté. » ©Antoine Magallon
Malgré cet élan de démocratisation du parkour, aucune fille n’est présente lors de cette semaine de formation. Pourtant, si une majorité des pratiquants est composée d’hommes, le parkour ne leur est pas réservé, loin de là.
Il est dix heures, le dimanche 7 février. Bien emmitouflés dans de lourds manteaux et de larges écharpes, quelques courageux bravent le froid hivernal qui a envahi Paris pour profiter du ciel bleu. Seules les quelques flaques d’eau qui parsèment les sentiers du parc de Bercy témoignent des fortes pluies qui sont tombées la veille. C’est ici, devant l’AccorHotels Arena, que ce sont donné rendez-vous les traceuses du Pink Parkour, l’association de parkour exclusivement féminine de la capitale. Elles ont organisé une journée d’initiation, avec la volonté de faire découvrir leur pratique à quelques novices.
© Elodie Troadec
Pink Parkour a vu le jour en décembre 2010, à l’initiative de deux traceuses, Stella Durand et Charlène Leglise. « A l’époque, il y avait très peu de filles qui pratiquaient. Elles n’osaient pas trop se lancer quand elles étaient entourées de garçons, relate Adélaïde Gandrille, la présidente de l’association. Stella et Charlène voulaient proposer un endroit où les filles pouvaient être libres. » Sur les 28 membres de l’association, seuls les trois coachs sont des hommes. « Si on allait au bout de notre logique, nos entraîneurs devraient aussi être des filles, mais c’est très compliqué d’en trouver à Paris », constate Juliette Boudet, la secrétaire de l’association et traceuse depuis un an et demi.
Dans le parc de Bercy, une vingtaine de personnes se sont réunies pour l’initiation. Elles ont découvert le parkour grâce au film Yamakasi, aux jeux vidéos ou à une connaissance. Quelques garçons se sont joints au groupe, qui entame la séance par un échauffement, avant de réaliser des enchaînements de sauts dans la fontaine Canyoneaustrate, vide à cette époque de l’année.
Discrète depuis la création de la discipline, la gent féminine est de plus en plus visible dans le milieu des traceurs. « On a l’image d’un sport pratiqué par des hommes hyper musclés, qui sautent de toit en toit et qui font des enchaînements dangereux, estime Adélaïde Grandille. Les filles se disent que ce n’est pas pour elles, alors que c’est un sport très complet et qu’elles ont certains atouts, comme la souplesse. »
Selon Samuel Govindin, l’un des trois coachs de l’association, rien n’empêche les filles de réussir aussi bien que leurs homologues masculins dans le parkour : « Les différences n’existent pas entre filles et garçons, seulement entre chaque personne. Chacun est différent, on part avec nos aptitudes et nos peurs propres. »
A midi, le groupe, à la recherche d’un nouveau spot, se déplace vers Créteil. Mais après plusieurs heures de pratique, les organismes des novices commencent à souffrir et les petites blessures se multiplient. « Les coachs ont une excellente condition physique, ils ne se rendent pas compte qu’après dix répétitions du même saut, on a mal partout », plaisante Typhanie.
17 h, le groupe remonte dans une rame de métro, direction Paris. Fatiguées, la peau des tibias râpée, des hématomes plein les bras, les filles n’en sont pas moins ravies. Et prêtes à recommencer dès le lendemain, lors de l’entraînement des « pinkettes » à Centr’Halles Park, la salle dédiée au parkour dans la capitale. Même Marie, qui s’est pourtant fait une entorse à la cheville, est enthousiaste. « Quand on rate un saut, ça donne encore plus de motivation pour recommencer et y arriver. » Loin des préoccupation des athlètes de haut niveau, traceurs professionnels et compétiteurs, pour qui l’enjeu du sport dépasse la simple passion.










